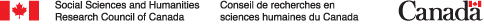Débat du 21 avril 1904 à
la Chambre d'assemblée de Terre-Neuve1
Le Très Hon. Premier ministre a déposé devant la Chambre une copie d'une Convention entre les gouvernements de Grande-Bretagne et de France vis-à-vis la Côte française de Terre-Neuve, et la correspondance connexe.2
Très Hon. Sir Robert Bond :3
C'est avec la plus profonde satisfaction que je puis aujourd'hui annoncer à la Chambre le résultat des négociations entre le gouvernement de Sa Majesté et celui de la France en rapport à la région de notre Colonie appelée Côte française. Pendant de nombreuses années, les habitants de cette Colonie ont enduré avec patience un état de choses plutôt inacceptable, une situation qui a réduit les milliers d'habitants des quelque 800 milles de littoral entre le cap John et le cap Ray à une condition gravement inférieure à celle de sujets britanniques. Autrement dit, sous les conditions qui y régnaient et qui ont été tolérées par le gouvernement de Sa Majesté durant de longues années, ces gens ne pouvaient pas prétendre à la pleine stature de citoyens de l'Empire. Leurs privilèges étaient réduits, leur ambition, contrée, et leurs droits comme sujets britanniques, ignorés et, dans certains cas, violemment réprimés.
Même si ces sujets de la Couronne de Grande-Bretagne vivaient sur la terre qui leur avait donné le jour; même s'ils contribuaient aux recettes de la Colonie et étaient de la sorte admissibles à la considération et à la protection qu'ils méritaient, ils ne pouvaient obtenir aucun titre sur le pays qui les avait vus grandir, et aucun droit de propriété sur les maisons que leur labeur ou celui de leurs ancêtres avaient bâties. Ils ne pouvaient pas exercer leur vocation sur ces eaux qui roulaient à leurs pieds, fourmillant de trésors sous forme de nourriture, de confort et d'indépendance, sauf s'ils y étaient autorisés par des sujets de France et, le cas advenant, seulement avec les agrès que les sujets de France leur permettaient d'utiliser. Dans leurs activités de tous les jours, ils vivaient dans la crainte constante d'être molestés, car si leur labeur leur accordait la chance de localiser un banc de poissons et que les pêcheurs de France s'en apercevaient, ceux-ci demandaient presque toujours au commandant de marine britannique de les chasser de leurs ancrages; s'ils protestaient, leurs filets et leurs autres engins de pêche étaient confisqués et souvent détruits. Et même les lois adoptées par notre Législature pour protéger et encadrer les pêches dans la Colonie étaient rendues inopérantes sur la moitié de notre littoral puisque le gouvernement de Sa Majesté, à l'insistance de la France, en interdisait l'application à la Côte française.
En outre, non seulement les meilleurs havres de la Côte française étaient-ils donnés aux pêcheurs de France à l'exclusion des sujets britanniques, non seulement les meilleurs fonds de pêche étaient-ils monopolisés par les pêcheurs de France, non seulement nos lois étaient-elles rendues inopérantes, mais la mise en valeur des richesses des terres de l'arrière pays, minérales et autres, était virtuellement fermée aux entreprises et aux capitaux, les aménagements côtiers requis pour leur transport étant refusés par la France, avec le consentement de l'Angleterre.
Année après année, cette plainte d'un peuple spolié et découragé est montée vers les cieux : « Combien de temps, Seigneur, combien de temps encore? » Ce ne sont que la loyauté et le dévouement remarquables de ces gens envers la Couronne qui ont empêché que du sang soit répandu et que l'Angleterre et la France entrent en guerre.
Finalement, et ce, en grande mesure grâce aux efforts personnels de Sa Majesté le Roi Édouard le Pacificateur, justice nous a été faite. (...)
Alors, Monsieur, nous allons brièvement comparer la situation passée à celle qui prévaut maintenant et décrire où en est la population de la Colonie aujourd'hui par rapport à la Côte française. Jusqu'à maintenant, les principaux havres qui existent entre le cap St. John à l'est et, vers le nord-ouest et le sud jusqu'au cap Ray, étaient la propriété de sujets de France : les sujets britannique en étaient exclus et ne pouvaient s'y bâtir une maison, y mener quelque commerce que ce soit ou y pêcher.
Le long des 800 milles de toute cette côte, ils ne pouvaient pêcher que par tolérance, car si les pêcheurs français s'objectaient à leur présence, le commandant de marine britannique exerçait ses fonctions de police et les chassait. En vertu d'un accord provisoire, le modus vivendi, ils pouvaient établir des conserveries de homard à certains endroits de la côte, mais même ce privilège était sujet à l'approbation de la France. L'industrie de chasse à la baleine ne pouvait être menée sur ce littoral, les Français prétendant qu'elle risquait de nuire à leur pêche de la morue, et l'Angleterre en a convenu pour garder la paix. Aucune exploitation minière ne pouvait y être menée, étant donné que les quais nécessaires à l'expédition du minerai étaient prétendument une nuisance contraire au Traité, d'autant plus que des doutes persistaient sur la propriété des terres visées par le Traité avec l'inclusion de « Clauses du Traité » dans tous les titres. L'agriculture était entravée pour des raisons similaires; de sorte que la totalité de cette vaste étendue du pays, considérée à juste titre comme la région la plus riche de l'île, reste à ce jour sous-développée et négligée. Telle est notre situation aujourd'hui. Que changera l'entrée en vigueur de la Convention à cette situation?
1. Cette île, que nombre d'entre nous aimons si chèrement en dépit de son sous-développement, de son isolement et de sa rudesse, physique et climatique, peut désormais être promue non seulement comme notre terre natale, mais comme notre propre terre, libre de réclamation étrangère et de l'influence abhorrée de toute oppression étrangère – nôtre dans son entièreté et seulement nôtre.
2. Le pêcheur peut y exercer son métier sans obstacle ou nuisance dans chaque ruisseau, anse et havre, aucun droit associé à la Côte française ne limitant sa liberté. Les gens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest seront en mesure de prendre le contrôle des stations qui étaient jusqu'à maintenant françaises et de capturer, le long de tout ce littoral qu'on appelait Côte française, le homard, la morue, le hareng, le saumon et toute autre espèce, et ce, sans risque d'être molestés.
3. L'industrie de chasse à la baleine, dont l'établissement était entravé sur les côtes ouest et nord-est en raison des objections de la France, pourra dorénavant être entreprise. (…)
4. Chaque pied carré du sol de l'île appartiendra désormais à notre peuple. Les zones minières, agricoles et boisées, jadis en attente de développement et virtuellement fermées par les contraintes liées au Traité, seront ouvertes aux entreprises et aux capitaux.
5. Les lois sur les pêches, jadis limitées à une portion de notre littoral, vont désormais s'appliquer partout dans l'Île et les commandants de marine n'auront plus l'ombre d'un pouvoir sur la fixation de règles et de règlements sur les conserveries de homard, ni sur la conduite ou la limitation d'autres formes de pêcheries.
6. Un consul britannique sera posté à Saint-Pierre, et la contrebande qui a spolié nos recettes de centaines de milliers de dollars cessera.
Quand nous considérons d'un œil impartial la situation antérieure, nous avons d'amples raisons de nous réjouir et d'être vraiment reconnaissants pour ce qui a été accompli. Après des années de vains efforts, le problème de la Côte française est enfin résolu. Résolu, en outre, sans sacrifier quelque intérêt de cette Colonie que ce soit. Nombreux sont ceux qui craignaient qu'une entente serait inatteignable sans une annulation ou une modification de la Loi sur les appâts, dont l'application affecte directement les intérêts français. Mais la Loi sur les appâts reste inchangée, et aucun nouveau privilège sur les appâts n'est partie de la Convention. Dorénavant, pour la capture d'appâts, comme de tout autre poisson sur notre côte ou nos eaux côtières, les pêcheurs de France seront assujettis à nos règles et règlements de pêche, comme à l'ensemble des autres règles et règlements approuvés par l'Assemblée.
Il convient aussi de rappeler qu'en vertu de cette Convention les Français doivent abandonner leurs hangars de pêche et leurs conserveries de homard sur tout le littoral. S'ils n'arrivaient pas à mener une pêche de la morue profitable quand ils avaient l'exclusivité des établissements où sécher ou saler leur poisson (et nous savons qu'ils en sont incapables depuis des années), nous pouvons conclure qu'ils abandonneront rapidement leurs pêcheries sur les côtes ouest et nord-est maintenant qu'une telle exclusivité leur a été retirée. Ils ne peuvent pas faire sécher leurs prises de morue sur nos côtes, et ils doivent immédiatement cesser de pêcher le homard puisque leurs conserveries seront fermées. Aucune autre convention n'a jamais envisagé l'abandon par les Français de leurs établissements sur la Côte française. Celle-ci accomplit encore plus, elle annonce une époque où même le souvenir de leur présence s'évanouira comme un rêve fébrile devant la splendeur d'un nouveau jour. C'est à nous désormais qu'il revient d'entamer par tout moyen légitime le développement et la colonisation de cette Côte qu'on appelait jusqu'à récemment française, et d'effacer de la sorte le souvenir de ce qui a trop longtemps été une malédiction pour ce pays et une tare pour le pouvoir britannique.
Je félicite cette Chambre, Monsieur, je félicite mes concitoyens de partout pour ce qui a été accompli, et je désire marquer un témoignage de ma gratitude au gouvernement de Sa Majesté, qui, aux frais de l'Empire, a libéré les habitants de cette Colonie de l'humiliation et des souffrances qu'ils ont endurées si longtemps et si patiemment dans l'intérêt de ce même Empire.
Mr. Morine:4
Je suppose qu'on me donnera l'occasion de lire les documents cités par le Premier ministre et le texte du traité, et que cet examen donnera éventuellement lieu à d'autres échanges. Entre-temps, fort de l'assurance du Très Hon. Premier ministre, mes observations resteront limitées, mais que j'y reviendrai dans un proche avenir si on m'en donne l'occasion.
Mes commentaires ici porteront sur les références historiques évoquées par le Premier ministre et sur le traité lui-même, tel que je le comprends. En ce qui a trait à l'histoire, et bien que le Premier ministre ait cité certains faits très intéressants, j'ai aussi relevé nombre d'omissions. Il ne faudrait pas oublier que le modus vivendi est d'abord entré en vigueur en 1890, le Gouvernement impérial s'étant dit résolu à adopter un projet de loi permanent, et à le renouveler tous les ans. Une telle éventualité a causé une forte agitation publique et une délégation a été envoyée à Londres. (...) En 1891, le projet de loi a été réintroduit et les deux organes de la Législature ont délégué à Londres un groupe de représentants, constitué de l'Hon. Moses Monroe et de l'Hon. M. Harvey, tous deux décédés depuis, du Président de la Chambre à l'époque, M. le juge Emerson, de Sir William Whiteway et de moi-même, pour s'opposer à ces dispositions. Nous avions pu nous adresser à la Chambre des Lords, alors que le projet de loi était sur le point d'être soumis à la Chambre des Communes, et le Gouvernement impérial [a convenu] de ne pas soumettre la question au Parlement impérial si le gouvernement de notre Colonie adoptait un projet de loi provisoire. Ce plan a été adopté. Nous avions rencontré le présent Premier ministre, qui était alors Premier ministre intérimaire, et lui avions présenté les observations et les recommandations des délégués.
Le Premier ministre a aussi négligé une étape très importante de ce processus. Le gros de l'entente avait été préparé par la Commission royale qui, dans la foulée des démarches de Sir James Winter et de moi-même, avait été déléguée ici. Ils étaient arrivés au nom du Gouvernement britannique prévenus contre la Colonie; or, mes observations ont amené les commissaires à changer d'avis. Le rapport produit par la Commission était si favorable à Terre-Neuve qu'il n'a jamais vu le jour depuis.5
Je crois par conséquent qu'aucune référence historique aux efforts déployés ne serait honnête ou correcte sans une mention de ces faits. Dans toute cette histoire, ces efforts ont certes eu l'influence la plus utile. Le rapport de cette Commission en 1898 aura été l'action la plus efficiente et efficace dans ce dossier. Me voici donc plutôt surpris que, dans son discours intéressant et certes conçu en tout impartialité, le Premier ministre ait oublié de mentionner ces deux éléments. Je fais ces critiques seulement et entièrement pour rendre justice à ceux qui, hors de l'Assemblée, ont joué un rôle crucial dans cette affaire; certains nous ont quittés pour un monde meilleur et d'autres, toujours en poste, n'ont pas eu la chance de faire valoir leurs efforts sur la scène publique.
En ce qui concerne le contenu du traité lui-même et l'interprétation qu'en a faite le Premier ministre, je prierais la Chambre et le public d'éviter les interprétations hâtives. Quant à la question du 20 octobre, je ne crois pas qu'il s'agisse de l'élément le plus important, malgré sa gravité, puisqu'elle ne concerne qu'une section, et non l'ensemble, de la population.
L'effet sur les privilèges liés aux appâts était le plus sérieux, mais il serait difficile d'en exagérer l'importance, et le langage utilisé par le gouvernement dans les télégrammes n'était en rien trop fort. Je n'étais pas prêt à accepter les assurances du gouvernement de Sa Majesté pour nous enlever tout doute, et je ne crois pas que le public aurait été justifié de les accepter, parce que nous devions interpréter le document comme une entente entre deux nations. Ce n'est pas l'interprétation que le gouvernement de Sa Majesté allait lui donner, ni même celle que les Français lui donneraient, mais bien celle qu'une cour de justice lui donnerait. (...)
Je voulais indiquer qu'il ne fallait pas se contenter de l'interprétation de l'Office des colonies. Le traitement de l'ancien traité nous a appris que les discours du Gouvernement impérial étaient sans valeur. Nous avons dit que les Français ne détenaient qu'un droit concurrent. Chaque premier ministre, depuis Lord Palmerston, a dit dans toutes les ententes que les Français n'ont jamais eu que des droits concurrents. Dans un langage sans équivoque, année après année tout au long du siècle, le gouvernement de Sa Majesté a répété que les Français n'avaient que des droits concurrents. Des navires de guerre ont été envoyés pour faire appliquer ces prétentions et par conséquent nous savions que ce que disait le Gouvernement britannique avait peu de poids face à ce que disaient les Français. La raison même de l'adoption du modus vivendi était que les Britanniques n'étaient pas disposés à reconnaître aux Français le droit de pêcher les crustacés le long de la côte. Une délégation après l'autre s'est rendue en Grande-Bretagne et le Gouvernement impérial n'a jamais été enclin à contester notre prétention, pas plus que nous n'acceptions de concéder le droit de prendre des homards sur tout le littoral, mais nous avons été contraints de soutenir et d'appuyer le Gouvernement britannique. (…)
Je n'ai pas eu la chance de lire attentivement la correspondance, et je me réserve le droit de poursuivre plus tard mes commentaires sur la Loi sur les appâts, mais je m'en voudrais de laisser l'optimisme du Tr. Hon. Premier ministre – ses prédictions optimistes – nous convaincre que tout va pour le mieux, qu'il n'y a absolument rien à craindre, qu'il ne faut se méfier de rien et que nous devons avaler ce traité au prix convenu par le Premier ministre et l'Office des Colonies. Je suis convaincu que le gouvernement de Sa Majesté a toujours été animé par les motifs les plus élevés. Au moment de l'adoption du modus vivendi, j'ai exprimé ma confiance envers le Gouvernement britannique, et j'ai encore confiance en lui. Il ne s'agissait pas de leur part d'un manque de volonté, mais d'un manque de connaissance intime sur ces questions de nature technique. À cet égard, il ne fallait pas s'attendre à ce que les politiciens britanniques comprennent entièrement nos préoccupations; il leur aurait fallu les lumières d'un représentant local pour choisir les termes les plus représentatifs de la volonté de la Colonie. Si le Très Hon. Premier ministre s'était rendu en Angleterre, l'article 2 aurait été différent. Je vous prie d'excuser le manque de détails de ces quelques observations, puisque je n'ai pas eu l'occasion de lire la correspondance ou le traité, mais je le ferai à la première occasion.
1. Jusqu'en 1909, les débats de la législature de Terre-Neuve n'étaient publiés que dans les journaux locaux. En 1904, l'Evening Telegram soutenait le gouvernement Libéral et avait le privilège d'imprimer les débats. The Daily News appuyait l'opposition Conservatrice.
Retour
2. Journal de la Chambre d'assemblée, 21 avril 1904.
Retour
3. Robert Bond (1857-1927). Premier ministre de Terre-Neuve de 1900 à 1909. Le discours est reproduit de l'Evening Telegram du 22 avril 1904.
Retour
4. Alfred B. Morine (1857-1944). Journaliste et avocat. Chef de l'Opposition. Son discours est reproduit de l'Evening Telegram des 28 et 30 mai 1904.
Retour
5. Pour un récit de ces événements, consulter : Thompson, Frederic F., The French Shore Problem in Newfoundland. An Imperial Study, Toronto, 1961
Retour